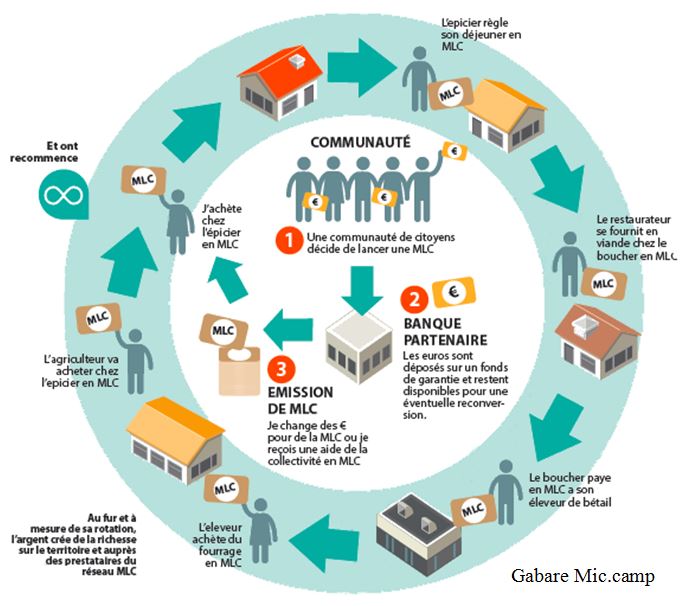J’ai profité de la présente année pour assouvir une grande passion chez moi, celle des voyages. J’ai eu la chance extraordinaire des personnes de l’Occident aisé de pouvoir parcourir le vaste monde pendant des mois, avec le minimum de contraintes, contrairement à la majorité des gens sur cette terre, limités par les frontières, les visas, les revenus insuffisamment élevés et autres contraintes bureaucratiques ou de différente nature. Le chemin sera long avant d’en arriver à un peu plus de justice dans ce domaine…
Mélanges de thérapie et d’aventures, plus efficaces que tous les antidépresseurs, les voyages sont pour ceux qui les aiment une grande bouffée d’oxygène dans une vie sévèrement soumise aux contraintes d’un travail qui relève de trop souvent de l’obsession, dans notre monde axé sur la performance.
Qui voyage s’instruit et s’enrichit, dit-on. Aujourd’hui, toutefois, tout voyageur est la plupart du temps confiné à l’univers étroit du tourisme, auquel personne ne peut échapper, même dans la saison la plus creuse. Le touriste est inévitablement un envahisseur, mais surtout une inépuisable ressource, qui fait vivre une industrie aux mille facettes, toujours plus développée. Ce touriste, il faut l’isoler, l’encadrer, lui faire voir ce qu’il veut bien voir, très souvent lui cacher le vrai visage du pays visité (après tout, il doit se détendre, s’amuser, ne pas trop se confronter aux dures réalités des peuples qu’il visite). Et il faut bien sûr, si possible, lui faire cracher un maximum de fric. Donner du rêve et assurer sa survie, dans des conditions souvent difficiles, voilà le grand contrat social qui régit l’univers du tourisme, surtout dans les pays où une grande partie de la population est victime de pauvreté.
Le point de vue du touriste sur le pays visité demeure ainsi très limité. Même s’il connaît la langue parlée, s’il suit les médias locaux et entre en contact avec des personnes bien informées, ses connaissances demeureront hasardeuses. Toutes ses informations seront partielles et partiales, et il sera difficile de séparer parmi elles le bon grain de l’ivraie. Il en résulte souvent une grande insatisfaction pour les personnes captivées par la politique et concernées par la justice sociale : prendre le pouls d’un pays, bien connaître sa situation demande du temps, de l’étude, de très bons contacts et plus encore. Ce que permet rarement un voyage presque toujours trop rapide.
Un cas particulier: Pérou vs Équateur
 C’est donc conscient de toutes ces limites que je me permets une courte réflexion sur deux pays que j’ai visités et qui m’ont fasciné, l’Équateur et le Pérou. Deux pays qui ont beaucoup en commun : un niveau de vie assez semblable, une géographie similaire, avec de vastes paysages andins, une grande forêt amazonienne peu peuplée, une côte du Pacifique qui regroupe une population nombreuse. Certes, l’Équateur est plus petit et se trouve quelque peu en périphérie de ce qui fut autrefois le vaste empire inca, puis le cœur de la colonisation espagnole dans la région. Mais surtout, en ce qui nous concerne, le Pérou est un indéfectible allié des États-Unis et un adepte des politiques néolibérales, alors que l’Équateur se distingue par ses politiques de gauche depuis l’arrivée de Raphaël Correa en 2007.
C’est donc conscient de toutes ces limites que je me permets une courte réflexion sur deux pays que j’ai visités et qui m’ont fasciné, l’Équateur et le Pérou. Deux pays qui ont beaucoup en commun : un niveau de vie assez semblable, une géographie similaire, avec de vastes paysages andins, une grande forêt amazonienne peu peuplée, une côte du Pacifique qui regroupe une population nombreuse. Certes, l’Équateur est plus petit et se trouve quelque peu en périphérie de ce qui fut autrefois le vaste empire inca, puis le cœur de la colonisation espagnole dans la région. Mais surtout, en ce qui nous concerne, le Pérou est un indéfectible allié des États-Unis et un adepte des politiques néolibérales, alors que l’Équateur se distingue par ses politiques de gauche depuis l’arrivée de Raphaël Correa en 2007.
Il serait donc tentant de voir dans ces deux pays, du point de vue de la justice sociale, le bon et le mauvais élève. Mais la réalité, comme toujours, est un peu plus compliquée. Pourtant, ce qui frappe le visiteur en Équateur, c’est le nombre important de nouvelles infrastructures: gare routière rutilante, superbe aéroport à Quito, belles routes, hôpitaux modernes, alors qu’il existe peu d’équivalent au Pérou. Dans les banlieues de ce dernier pays, en particulier, on observe une flagrante pauvreté, des rues non pavées et poussiéreuses, des chiens errants et misérables… On peut donc penser qu’en Équateur, la richesse est mieux distribuée, ce qui n’est pas faux. Le pays a aussi profité d’une importante manne pétrolière (qui a cessé depuis de tomber), et s’est beaucoup réendetté, si bien que le problème de l’endettement, qui avait été en partie réduit par une politique audacieuse de Correa, est redevenu menaçant.
Mais le problème principal du gouvernement est d’avoir considéré tous ses opposants comme des adversaires à combattre et de s’en être pris plus particulièrement au mouvement social. Il est ainsi parvenu à affaiblir un grand nombre d’associations qui le contestaient pour de bonnes raisons par des ONG que lui-même finançait et qui se montraient forcément très complaisantes. Gouverner à gauche, mais en réprimant le mouvement social et en tordant le cou à la démocratie n’est certes pas ce qu’on attend d’un gouvernement progressiste. Le nouveau gouvernement de Lenine Moreno ne se montre pas aussi autoritaire et est même parvenu, par le biais d’un référendum aisément gagné, à empêcher tout retour à la présidence de Correa. Mais cela s’est fait au prix d’un rapprochement avec la droite qui en inquiète plusieurs.
Au Pérou, les inégalités sociales semblent plus visibles aux yeux des visiteurs. Des problèmes très graves nous ont été signalés, comme le budget de l’éducation publique, qui demeure près de 3% du PIB. Un si faible financement se fait aux dépens de tout le monde dans le pays: autant des élèves et des étudiants, qui peuvent ainsi difficilement avoir accès à une éducation de qualité, du personnel dans les écoles, qui gagne un salaire nettement insuffisant, et la population toute entière, pouvant difficilement profiter d’un savoir assez répandu pour permettre un meilleur développement.
Mais la réaction s’organise, bien que ce soit dans des conditions difficiles. À Puno, sur le bord du lac Titicaca, j’ai été témoin de deux journées intenses de grèves et de manifestations. Bien qu’il soit difficile de prendre l’exacte mesure de la vigueur du mouvement social, il m’a semblé que les Péruviens ne se résignent pas complètement à leur sort. La démission du premier ministre Pedro Pablo Kuczynski pour cause de corruption, au moment où je m’y trouvais, reste un signe que tout n’est plus permis dans ce pays, de la part des élites dominantes.
À circuler au Pérou et en Équateur, nous avons souvent l’impression de voyager dans des pays de géants. Tout y est d’extraordinaires dimensions: les volcans, les montagnes, les plateaux, les déserts, les vestiges du passé… Mais aussi les problèmes qui assaillent les populations: la corruption, la pauvreté, les atteintes à la démocratie. Venir à bout de ces problèmes est un défi colossal qu’il leur faut relever, avec un certain avantage pour l’Équateur, du moins pour le moment.
Persistance du néolibéralisme
 Mais ce qui m’a surtout frappé au cours de mes pérégrinations, c’est de voir à quel point le néolibéralisme ressemble à un phœnix qui renaît sans cesse de ses cendres, et cela malgré l’insatisfaction qu’il entraîne et les catastrophes qu’il provoque. Cette situation a été dénoncée à l’Université d’été européenne des mouvements sociaux tenue à Toulouse en août dernier. Peu importe le pays dont il est question, il reste toujours des budgets à compresser, des services publics à privatiser, des accords de libre-échange à conclure. Ce système économique avance comme un char d’assaut, lentement et sûrement, imperturbable, à l’abris de tout. On sentait, pendant cette université d’été, une forme de découragement. D’autant plus que par un grand malentendu, c’est l’extrême-droite qui profite le plus de l’indignation généralisée. Et cela même si elle ne remet pas vraiment ce système en cause, ne propose rien d’efficace pour renverser la situation, et ne peut au contraire que la rendre pire.
Mais ce qui m’a surtout frappé au cours de mes pérégrinations, c’est de voir à quel point le néolibéralisme ressemble à un phœnix qui renaît sans cesse de ses cendres, et cela malgré l’insatisfaction qu’il entraîne et les catastrophes qu’il provoque. Cette situation a été dénoncée à l’Université d’été européenne des mouvements sociaux tenue à Toulouse en août dernier. Peu importe le pays dont il est question, il reste toujours des budgets à compresser, des services publics à privatiser, des accords de libre-échange à conclure. Ce système économique avance comme un char d’assaut, lentement et sûrement, imperturbable, à l’abris de tout. On sentait, pendant cette université d’été, une forme de découragement. D’autant plus que par un grand malentendu, c’est l’extrême-droite qui profite le plus de l’indignation généralisée. Et cela même si elle ne remet pas vraiment ce système en cause, ne propose rien d’efficace pour renverser la situation, et ne peut au contraire que la rendre pire.
Les difficultés de l’économie sont particulièrement grandes dans les pays du sud de l’Europe. Un ami d’Attac en Grèce nous a fait part des sacrifices des Grecs aux lendemains de la terrible crise dont ils commencent à peine à se relever : une perte généralisée du tiers de leurs revenus, déjà pas très élevés auparavant, en ce qui concerne les salaires et les retraites. Même les services offerts à la population, beaucoup moins efficaces qu’auparavant, perdraient quelque chose comme le tiers de leur efficacité. Mais des liens sociaux très forts dans ce pays ont réussi à éviter la catastrophe et ont permis aux gens d’encaisser de terribles coups.
De façon inattendue, parce qu’on a beaucoup moins parlé de cette région, le sud de l’Italie porte peut-être les marques plus visibles d’une crise qui n’en finit plus. La Sicile en particulier est victime d’un dépeuplement que vient compenser en partie une importante immigration africaine. Cette immigration comble de grands besoins, si bien que le racisme semble moins présent qu’ailleurs dans le pays ou en Europe. Mais le problème de la pauvreté demeure bien réel, l’économie est très fragile et la région, un peu ostracisée par le reste du pays — on l’a vu pendant les dernières élections en Italie — reçoit un faible soutien étatique.
À voyager ainsi dans de nombreux pays, on se dit qu’il ne serait pas si difficile de s’arranger pour que les choses aillent beaucoup mieux pour tant de gens. La soumission de ceux qui gouvernent aux classes dominantes a un peu partout la même conséquence d’empêcher les réformes axées sur les besoins réels des populations. Cela, bien sûr, on le sait en restant chez soi. Mais on l’éprouve aussi, avec force, à se déplacer longuement, même saisi par la fascination et le plaisir constants que procurent les voyages.




 Depuis quelque temps, des sociétés, des mouvements, voire, dans le cas de l’Amérique du Sud, des États, ont commencé à remettre en question ce cadre, entre autres à cause de l’instabilité sociale et économique que cela implique. Ici au Canada cependant, les gouvernements, y compris le présent gouvernement Trudeau, ont maintenu le cap, prétendant que le plus grave danger proviendrait du protectionnisme, plutôt que la dérèglementation néolibérale. Ottawa voudrait mobiliser la société pour appuyer le maintien des accords de libre-échange contre la catastrophe annoncée du protectionnisme, associé à la montée de la droite xénophobe en Amérique comme en Europe.
Depuis quelque temps, des sociétés, des mouvements, voire, dans le cas de l’Amérique du Sud, des États, ont commencé à remettre en question ce cadre, entre autres à cause de l’instabilité sociale et économique que cela implique. Ici au Canada cependant, les gouvernements, y compris le présent gouvernement Trudeau, ont maintenu le cap, prétendant que le plus grave danger proviendrait du protectionnisme, plutôt que la dérèglementation néolibérale. Ottawa voudrait mobiliser la société pour appuyer le maintien des accords de libre-échange contre la catastrophe annoncée du protectionnisme, associé à la montée de la droite xénophobe en Amérique comme en Europe.
 C’est donc conscient de toutes ces limites que je me permets une courte réflexion sur deux pays que j’ai visités et qui m’ont fasciné, l’Équateur et le Pérou. Deux pays qui ont beaucoup en commun : un niveau de vie assez semblable, une géographie similaire, avec de vastes paysages andins, une grande forêt amazonienne peu peuplée, une côte du Pacifique qui regroupe une population nombreuse. Certes, l’Équateur est plus petit et se trouve quelque peu en périphérie de ce qui fut autrefois le vaste empire inca, puis le cœur de la colonisation espagnole dans la région. Mais surtout, en ce qui nous concerne, le Pérou est un indéfectible allié des États-Unis et un adepte des politiques néolibérales, alors que l’Équateur se distingue par ses politiques de gauche depuis l’arrivée de Raphaël Correa en 2007.
C’est donc conscient de toutes ces limites que je me permets une courte réflexion sur deux pays que j’ai visités et qui m’ont fasciné, l’Équateur et le Pérou. Deux pays qui ont beaucoup en commun : un niveau de vie assez semblable, une géographie similaire, avec de vastes paysages andins, une grande forêt amazonienne peu peuplée, une côte du Pacifique qui regroupe une population nombreuse. Certes, l’Équateur est plus petit et se trouve quelque peu en périphérie de ce qui fut autrefois le vaste empire inca, puis le cœur de la colonisation espagnole dans la région. Mais surtout, en ce qui nous concerne, le Pérou est un indéfectible allié des États-Unis et un adepte des politiques néolibérales, alors que l’Équateur se distingue par ses politiques de gauche depuis l’arrivée de Raphaël Correa en 2007. Mais ce qui m’a surtout frappé au cours de mes pérégrinations, c’est de voir à quel point le néolibéralisme ressemble à un phœnix qui renaît sans cesse de ses cendres, et cela malgré l’insatisfaction qu’il entraîne et les catastrophes qu’il provoque. Cette situation a été dénoncée à l’Université d’été européenne des mouvements sociaux tenue à Toulouse en août dernier. Peu importe le pays dont il est question, il reste toujours des budgets à compresser, des services publics à privatiser, des accords de libre-échange à conclure. Ce système économique avance comme un char d’assaut, lentement et sûrement, imperturbable, à l’abris de tout. On sentait, pendant cette université d’été, une forme de découragement. D’autant plus que par un grand malentendu, c’est l’extrême-droite qui profite le plus de l’indignation généralisée. Et cela même si elle ne remet pas vraiment ce système en cause, ne propose rien d’efficace pour renverser la situation, et ne peut au contraire que la rendre pire.
Mais ce qui m’a surtout frappé au cours de mes pérégrinations, c’est de voir à quel point le néolibéralisme ressemble à un phœnix qui renaît sans cesse de ses cendres, et cela malgré l’insatisfaction qu’il entraîne et les catastrophes qu’il provoque. Cette situation a été dénoncée à l’Université d’été européenne des mouvements sociaux tenue à Toulouse en août dernier. Peu importe le pays dont il est question, il reste toujours des budgets à compresser, des services publics à privatiser, des accords de libre-échange à conclure. Ce système économique avance comme un char d’assaut, lentement et sûrement, imperturbable, à l’abris de tout. On sentait, pendant cette université d’été, une forme de découragement. D’autant plus que par un grand malentendu, c’est l’extrême-droite qui profite le plus de l’indignation généralisée. Et cela même si elle ne remet pas vraiment ce système en cause, ne propose rien d’efficace pour renverser la situation, et ne peut au contraire que la rendre pire.