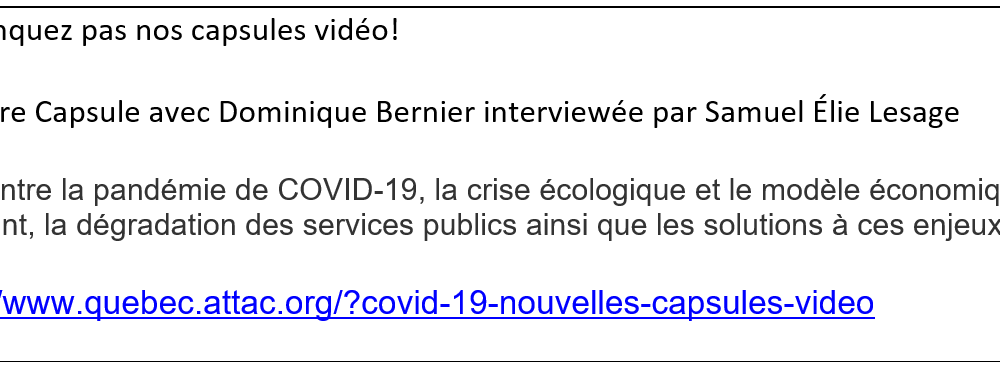Alors que pandémie oblige, nous consommons encore plus les réseaux sociaux, l’écoute de vidéos en continu, les services de vidéoconférences et de télétravail, nous pouvons penser que la crise du coronavirus deviendra un point historique confirmant la consécration d’un capitalisme numérique. Cette économie des Amazon, Netflix, Google, Alibaba nous interpelle à différents niveaux, notamment par l’absence d’une fiscalité adéquate pour ces grandes sociétés, de plus en plus omniprésentes et omnipotentes, qui leur évite de payer leur juste part d’impôt et de taxes. On pense également aux grandes inégalités numériques que l’on peut observer. Toutefois, il se pose des questions encore plus fondamentales sur l’urgence écologique et sur le respect de nos libertés et droits.
Enjeu écologique
Sur le plan environnemental, nous savions déjà que l’industrie numérique participait, avant cette explosion reliée à la crise sanitaire, aux environs de 4 % des émissions des gaz à effet de serre soit autant que ce qui a été émis par la flotte mondiale de camions, ou deux fois les émissions du transport aérien. Le numérique, c’est aussi désormais environ 10% de l’électricité mondiale (les serveurs en consommant 4% à eux seuls) et 80 % des données qui transitent concernent la vidéo. Rappelons que l’on estime que 40 % de l’énergie électrique est produit par des centrales à charbon et 25 % par des centrales à gaz. Pire, l’empreinte carbone de l’industrie numérique augmente de presque 10 % par an, de telle sorte qu’avant 2025, une poursuite de la tendance amènerait le digital à être aussi polluant que le milliard de voitures qui contribuent 6% des émissions mondiales. Nous savons qu’il faut consommer 2000 kilowatts-heures d’énergie et émettre une demi-tonne de CO2 en moyenne pour fabriquer un ordinateur portable, lequel contient 40 métaux différents pour l’essentiel, présents en quantité bien trop faible, pour être recyclés ensuite. S’ajoute la connectivité des objets, soit un autre besoin qui nous est imposé et surtout l’arrivée du 5G qui fera doubler ou tripler la consommation énergétique dans les prochaines années. Cet enjeu environnemental s’offre à nous par le biais de la volonté de l’implantation de cette nouvelle technologie. Il ne fait pas de doute que la Covid-19, et le confinement qu’elle a provoqué, a eu pour effet non seulement d’augmenter l’utilisation d’Internet pour les communications et les contenus, mais de créer un sentiment positif envers les fournisseurs et la construction d’un nouveau besoin essentiel de ces technologies pour la suite des choses. Serons-nous capables de reconvertir ces nouvelles habitudes de consommation ? Serons-nous en mesure, d’une part, d’arrêter le processus d’implantation d’une technologie impulsée par les grandes corporations? Nous entendrons dire qu’il faut relancer l’économie, qu’il faut être compétitif, que les accords commerciaux nous obligent à ne pas brimer la liberté de commerce, bref que nous n’avons pas le choix. Comme d’habitude, ce choix nous sera imposé sans véritable débat démocratique à moins que … nous puissions reprendre ce contrôle par le biais d’une transformation politique qui vise à mettre l’humain en priorité. Reste à établir comment y arriver.
Capitalisme de surveillance
 Depuis 20 ans, sous le couvert de service gratuit, les Google, Facebook, Amazon et Microsoft de ce monde ont forgé, petit à petit, grâce à la technologie et à la capacité des calculs des algorithmes, un réseau de collectes de données personnelles, sans précédent. Alors que les collectes d’information leur permettaient au départ d’extraire des données visant à améliorer leurs services, il s’agit désormais de lire littéralement dans la pensée des utilisateurs et utilisatrices, au détriment de la vie privée afin de satisfaire leurs propres intérêts. Rentabiliser et marchandiser toutes les activités humaines mêmes les plus intimes, voilà le concept du capitalisme de surveillance que décrit la sociologue Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs). Selon elle, la technologie est un outil de contrôle invisible ; elle réduit la liberté des individus sans qu’ils s’en rendent nécessairement compte. Nous sommes passés d’une société reposant sur la division du travail à une organisation basée sur la division du savoir; de la propriété des moyens de production à la propriété des moyens de produire du sens. Certaines entreprises détiennent désormais suffisamment d’informations sur nous pour influencer nos comportements au service d’objectifs économiques, dans un glissement du contrôle vers l’action. Mais aussi pour manipuler l’opinion publique comme dans l’affaire Cambridge Analytica, alors que l’appropriation des données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook a joué un rôle-clef dans l’élection de Donald Trump ainsi que dans le vote en faveur du Brexit. Déjà, en juin 2017, une étude de l’Université d’Oxford concluait que Facebook et Twitter étaient devenus des outils de contrôle social. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en politique. Évidemment, il n’existe aucune régulation, sauf dernièrement en Europe, pour ce secteur qui usurpe la vie privée et mine la démocratie. Mais il y a pire encore.
Depuis 20 ans, sous le couvert de service gratuit, les Google, Facebook, Amazon et Microsoft de ce monde ont forgé, petit à petit, grâce à la technologie et à la capacité des calculs des algorithmes, un réseau de collectes de données personnelles, sans précédent. Alors que les collectes d’information leur permettaient au départ d’extraire des données visant à améliorer leurs services, il s’agit désormais de lire littéralement dans la pensée des utilisateurs et utilisatrices, au détriment de la vie privée afin de satisfaire leurs propres intérêts. Rentabiliser et marchandiser toutes les activités humaines mêmes les plus intimes, voilà le concept du capitalisme de surveillance que décrit la sociologue Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs). Selon elle, la technologie est un outil de contrôle invisible ; elle réduit la liberté des individus sans qu’ils s’en rendent nécessairement compte. Nous sommes passés d’une société reposant sur la division du travail à une organisation basée sur la division du savoir; de la propriété des moyens de production à la propriété des moyens de produire du sens. Certaines entreprises détiennent désormais suffisamment d’informations sur nous pour influencer nos comportements au service d’objectifs économiques, dans un glissement du contrôle vers l’action. Mais aussi pour manipuler l’opinion publique comme dans l’affaire Cambridge Analytica, alors que l’appropriation des données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook a joué un rôle-clef dans l’élection de Donald Trump ainsi que dans le vote en faveur du Brexit. Déjà, en juin 2017, une étude de l’Université d’Oxford concluait que Facebook et Twitter étaient devenus des outils de contrôle social. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en politique. Évidemment, il n’existe aucune régulation, sauf dernièrement en Europe, pour ce secteur qui usurpe la vie privée et mine la démocratie. Mais il y a pire encore.
La stratégie de choc
Profitant des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis, qui s’auréolent d’être le pays démocratique, ont promulgué le Patriot act qui autorisait les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les personnes utilisatrices. Cette loi temporaire a été reconduite à deux reprises, jusqu’en 2015. Par la suite, le Congrès américain, en 2018, a adopté le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act ) qui permet notamment aux forces de l’ordre américain d’obtenir les données personnelles d’un individu sans que celui-ci en soit informé, ni que son pays de résidence ne le soit, ni que le pays où sont stockées ces données ne le soit. Ceci, sans compter les révélations sur les pratiques des services de sécurité dévoilées par Edward Snowden, au péril de sa vie, sur les violations des autorités quant à la captation des métadonnées des communications téléphoniques et sur Internet. En matière de contrôle et de surveillance, la Chine fait encore mieux : elle a mis en place un système qui attribue des notes à ses citoyen.enne.s en fonction de leurs comportements à l’école, au travail ou sur les réseaux sociaux, grâce aux données collectées et par le développement de la reconnaissance faciale. Il est à noter que ce contrôle social est bien accepté par une partie de la population. D’ailleurs, un grand nombre de personnes participent de manière volontaire aux expérimentations et y voient plus d’avantages personnels (distinction, reconnaissance, bonne réputation) et collectifs (sécurité, confiance) que d’inconvénients.
Et la Covid-19 arriva
Intelligence artificielle et contrôle des données sur les déplacements des personnes confinées: déjà les grandes entreprises proposent des solutions aux autorités afin de leur fournir des informations qui permettraient d’identifier non seulement le statut sanitaire des individus, mais également celui des personnes qu’ils ont rencontrées, La sortie du confinement risque de nous amener à reprendre ce que les pays asiatiques ont pratiqué depuis le début, à savoir de tester énormément et de suivre numériquement des personnes. Que dire du choix d’Israël d’autoriser les services de contre-espionnage à procéder à la surveillance électronique de sa population pour enrayer la propagation du Covid-19. En fait, ces outils sont les mêmes que ceux utilisés contre le terrorisme et sont très invasifs pour la vie privée.
Le risque d’une société de surveillance monte d’un cran.
Nous pouvons constater déjà que la pandémie a jusqu’ici suscité une grande adhésion des mesures limitant l’exercice des libertés fondamentales. Mais attention comme le disait Marco Bensani, un membre d’Attac-Italie : «Une des stratégies les plus efficaces mises en œuvre dans toute situation d’urgence par les pouvoirs forts consiste à culpabiliser les individus pour obtenir d’eux qu’ils intériorisent la narration déterminante sur les évènements en cours, afin d’éviter toute forme de rébellion envers l’Ordre constitué.» Au moment où se déroulent les débats sur la mise en place de mécanisme de surveillances de nos déplacements et nos interrelations humaines sous la responsabilité d’un petit nombres de personnes et d’entreprises, il est nécessaire de questionner les dangers de cette sorte de servitude volontaire. À long terme elle pourrait finir par se conjuguer avec la nécessité de se contraindre pour devenir une ou un citoyen responsable et faire accepter des mesures qui contraignent la liberté publique.
Technologie 5 G
Tous ces enjeux se déroulent dans un contexte de lutte technologique entre la Chine et les États-Unis dans le cadre de l’implantation de la technologie 5 G. Des accusations d’espionnage ont été lancées contre la compagnie Huawei qui pourrait en profiter pour infiltrer le cœur des réseaux de communication. Déjà l’application chinoise WeChat peut copier toutes les données, les contacts, les photos, les messages sur ses serveurs logés en Chine et savoir en permanence où vous êtes. Comme toutes les applications offertes par les géants du Web. Sauf que WeChat, en tant que société chinoise, doit tenir toutes ces données à la disposition des autorités chinoises : c’est écrit noir sur blanc dans les conditions de service. Ils n’ont pas le choix. Bref, nous sommes déjà espionnés en permanence et en l’occurrence, nous le sommes au profit d’un État policier. «Si les Américains, qui ne sont pas les derniers à espionner de cette manière, s’en préoccupent, c’est que la menace est réelle», disait le journaliste Nicolas Barré sur Europe 1. Dans ce contexte, demandons-nous si nous pouvons échapper à ce capitalisme de surveillance. L’heure est désormais à un débat plus large sur le rôle de la surveillance dans notre société de plus en plus numérisée.
 Le confinement et l’obligation de distanciation sociale agissent également sur le vivre en ville. On redécouvre la marche et le vélo avec comme conséquence que nos rues tout à l’auto n’y sont pas favorables : trottoirs pas assez larges pour respecter la distanciation.
Le confinement et l’obligation de distanciation sociale agissent également sur le vivre en ville. On redécouvre la marche et le vélo avec comme conséquence que nos rues tout à l’auto n’y sont pas favorables : trottoirs pas assez larges pour respecter la distanciation.






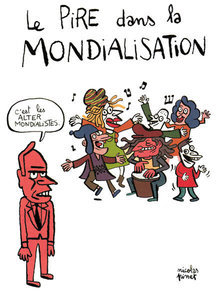 ailleurs à la financiarisation et à l’endettement, exige une déréglementation universelle des législations contraignantes au commerce. Elle exige la mise en place de mécanismes permettant l’appropriation sans contrainte de richesses, comme la réduction des impôts sur le capital et la légalisation de l’évasion fiscale! Pour les mêmes raisons, la délocalisation des sites de production et leur intégration mondiale furent des fers de lance de cette mondialisation du capital. Par ailleurs, elle implique des encadrements supranationaux et prévoit des ajustements structurels auprès des pays les plus en difficulté. Les accords de libre-échange ne sont pas seulement un exercice de réduction des barrières douanières, ils offrent aux grandes entreprises un pouvoir accru devant les États nationaux. La mondialisation néolibérale promettait l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Elle a eu comme impact un enrichissement des grandes corporations et des investisseurs transnationaux, en accentuant les inégalités entre les pays du Nord et du Sud et au sein des pays du Sud comme du Nord.
ailleurs à la financiarisation et à l’endettement, exige une déréglementation universelle des législations contraignantes au commerce. Elle exige la mise en place de mécanismes permettant l’appropriation sans contrainte de richesses, comme la réduction des impôts sur le capital et la légalisation de l’évasion fiscale! Pour les mêmes raisons, la délocalisation des sites de production et leur intégration mondiale furent des fers de lance de cette mondialisation du capital. Par ailleurs, elle implique des encadrements supranationaux et prévoit des ajustements structurels auprès des pays les plus en difficulté. Les accords de libre-échange ne sont pas seulement un exercice de réduction des barrières douanières, ils offrent aux grandes entreprises un pouvoir accru devant les États nationaux. La mondialisation néolibérale promettait l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Elle a eu comme impact un enrichissement des grandes corporations et des investisseurs transnationaux, en accentuant les inégalités entre les pays du Nord et du Sud et au sein des pays du Sud comme du Nord.
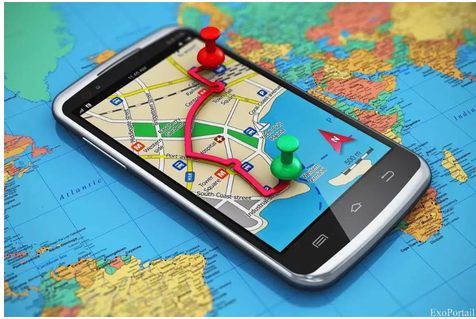
 Depuis 20 ans, sous le couvert de service gratuit, les Google, Facebook, Amazon et Microsoft de ce monde ont forgé, petit à petit, grâce à la technologie et à la capacité des calculs des algorithmes, un réseau de collectes de données personnelles, sans précédent. Alors que les collectes d’information leur permettaient au départ d’extraire des données visant à améliorer leurs services, il s’agit désormais de lire littéralement dans la pensée des utilisateurs et utilisatrices, au détriment de la vie privée afin de satisfaire leurs propres intérêts. Rentabiliser et marchandiser toutes les activités humaines mêmes les plus intimes, voilà le concept du capitalisme de surveillance que décrit la sociologue Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs). Selon elle, la technologie est un outil de contrôle invisible ; elle réduit la liberté des individus sans qu’ils s’en rendent nécessairement compte. Nous sommes passés d’une société reposant sur la division du travail à une organisation basée sur la division du savoir; de la propriété des moyens de production à la propriété des moyens de produire du sens. Certaines entreprises détiennent désormais suffisamment d’informations sur nous pour influencer nos comportements au service d’objectifs économiques, dans un glissement du contrôle vers l’action. Mais aussi pour manipuler l’opinion publique comme dans l’affaire Cambridge Analytica, alors que l’appropriation des données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook a joué un rôle-clef dans l’élection de Donald Trump ainsi que dans le vote en faveur du Brexit. Déjà, en juin 2017, une étude de l’Université d’Oxford concluait que Facebook et Twitter étaient devenus des outils de contrôle social. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en politique. Évidemment, il n’existe aucune régulation, sauf dernièrement en Europe, pour ce secteur qui usurpe la vie privée et mine la démocratie. Mais il y a pire encore.
Depuis 20 ans, sous le couvert de service gratuit, les Google, Facebook, Amazon et Microsoft de ce monde ont forgé, petit à petit, grâce à la technologie et à la capacité des calculs des algorithmes, un réseau de collectes de données personnelles, sans précédent. Alors que les collectes d’information leur permettaient au départ d’extraire des données visant à améliorer leurs services, il s’agit désormais de lire littéralement dans la pensée des utilisateurs et utilisatrices, au détriment de la vie privée afin de satisfaire leurs propres intérêts. Rentabiliser et marchandiser toutes les activités humaines mêmes les plus intimes, voilà le concept du capitalisme de surveillance que décrit la sociologue Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs). Selon elle, la technologie est un outil de contrôle invisible ; elle réduit la liberté des individus sans qu’ils s’en rendent nécessairement compte. Nous sommes passés d’une société reposant sur la division du travail à une organisation basée sur la division du savoir; de la propriété des moyens de production à la propriété des moyens de produire du sens. Certaines entreprises détiennent désormais suffisamment d’informations sur nous pour influencer nos comportements au service d’objectifs économiques, dans un glissement du contrôle vers l’action. Mais aussi pour manipuler l’opinion publique comme dans l’affaire Cambridge Analytica, alors que l’appropriation des données personnelles de 50 millions d’utilisateurs de Facebook a joué un rôle-clef dans l’élection de Donald Trump ainsi que dans le vote en faveur du Brexit. Déjà, en juin 2017, une étude de l’Université d’Oxford concluait que Facebook et Twitter étaient devenus des outils de contrôle social. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en politique. Évidemment, il n’existe aucune régulation, sauf dernièrement en Europe, pour ce secteur qui usurpe la vie privée et mine la démocratie. Mais il y a pire encore.
 On a répété ad nauseam comment la pandémie était un révélateur des contradictions sociales qui lézardent notre société. En voilà une qui, toutefois, n’est pas adressée avec la gravité qu’elle requiert : le fait que des multinationales non seulement profitent de la pandémie, mais le font tout en continuant à s’immiscer dans nos vies de sorte à se rendre indispensables. Innovations technologiques comportant des dérives sécuritaires et développements de moyens de communication toujours plus efficaces à nous maintenir connectés, le crédo du technocapitalisme ne semble pas s’arrêter en temps de pandémie. Bien au contraire, la crise du coronavirus semble n’être pour lui qu’une nouvelle opportunité à saisir. Le fait que cette situation se maintienne doit nous ouvrir les yeux sur notre état de dépendance aux services et produits offerts en ligne, le tout accessible par l’entremise de nos ordinateurs et autres appareils supposément intelligents – bref, de notre encadrement numérique. Le très haut niveau d’intégration de ces entreprises dans nos vies en vient à bloquer quasiment toute possibilité de vivre en dehors de l’encadrement numérique.
On a répété ad nauseam comment la pandémie était un révélateur des contradictions sociales qui lézardent notre société. En voilà une qui, toutefois, n’est pas adressée avec la gravité qu’elle requiert : le fait que des multinationales non seulement profitent de la pandémie, mais le font tout en continuant à s’immiscer dans nos vies de sorte à se rendre indispensables. Innovations technologiques comportant des dérives sécuritaires et développements de moyens de communication toujours plus efficaces à nous maintenir connectés, le crédo du technocapitalisme ne semble pas s’arrêter en temps de pandémie. Bien au contraire, la crise du coronavirus semble n’être pour lui qu’une nouvelle opportunité à saisir. Le fait que cette situation se maintienne doit nous ouvrir les yeux sur notre état de dépendance aux services et produits offerts en ligne, le tout accessible par l’entremise de nos ordinateurs et autres appareils supposément intelligents – bref, de notre encadrement numérique. Le très haut niveau d’intégration de ces entreprises dans nos vies en vient à bloquer quasiment toute possibilité de vivre en dehors de l’encadrement numérique.
 La fiscaliste Brigitte Alepin prône «une taxe sur la richesse», qui consiste à imposer les plus riches Canadiens à un taux exceptionnel de 1 % sur leur fortune pour compenser les sacrifices qui ont été réclamés à la population. Si on ne taxait qu’au taux de 1% le patrimoine des dix familles les plus riches au Québec, qui avaient une valeur nette totale en 2019 de 25,6 milliards$, cela rapporterait 256 millions$ par année.
La fiscaliste Brigitte Alepin prône «une taxe sur la richesse», qui consiste à imposer les plus riches Canadiens à un taux exceptionnel de 1 % sur leur fortune pour compenser les sacrifices qui ont été réclamés à la population. Si on ne taxait qu’au taux de 1% le patrimoine des dix familles les plus riches au Québec, qui avaient une valeur nette totale en 2019 de 25,6 milliards$, cela rapporterait 256 millions$ par année.